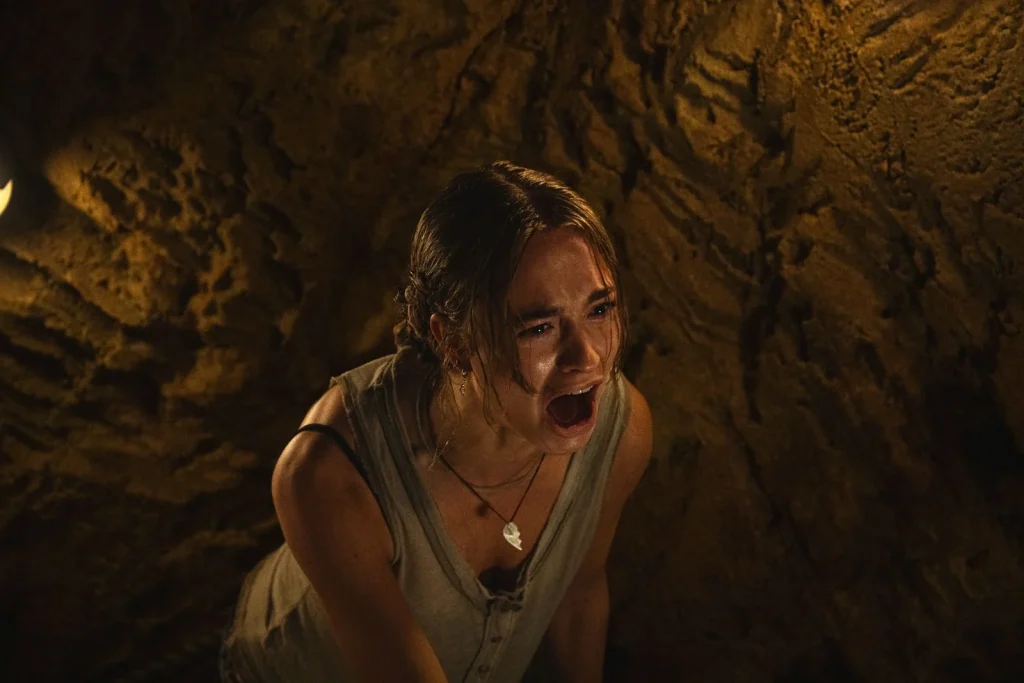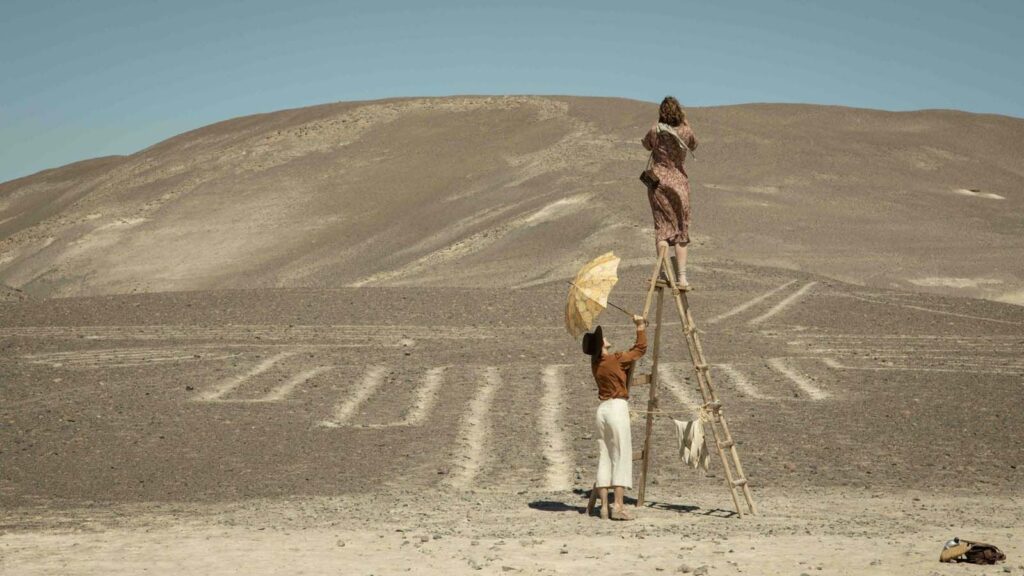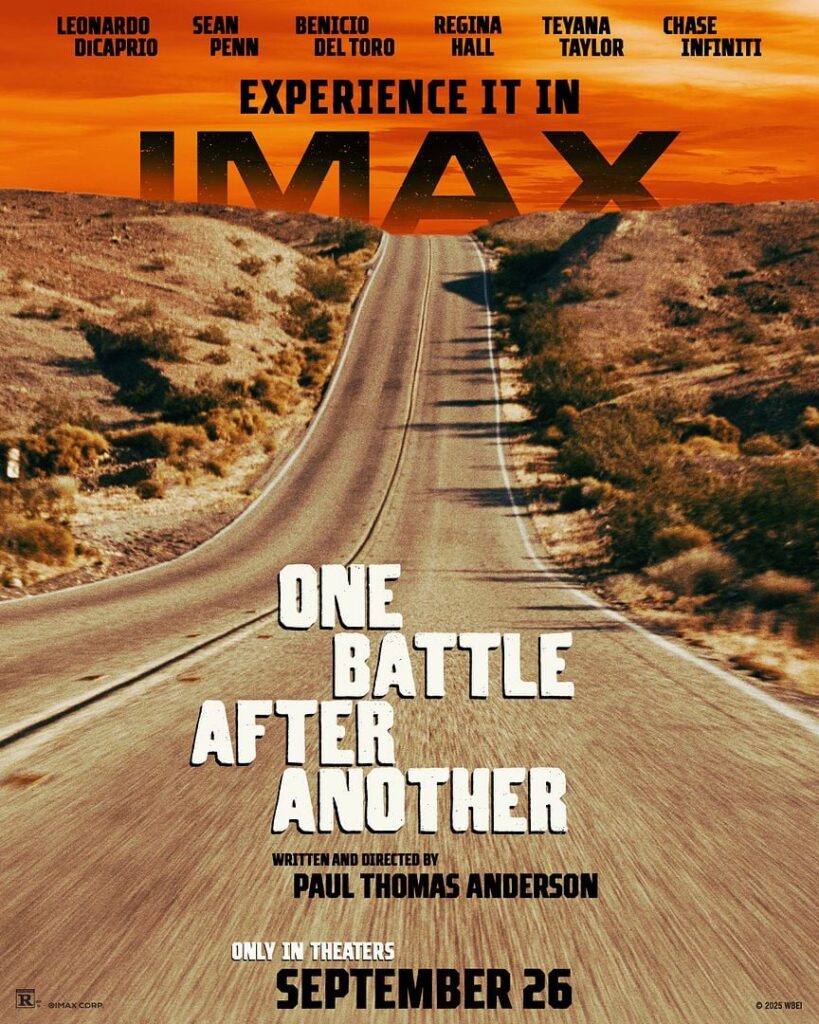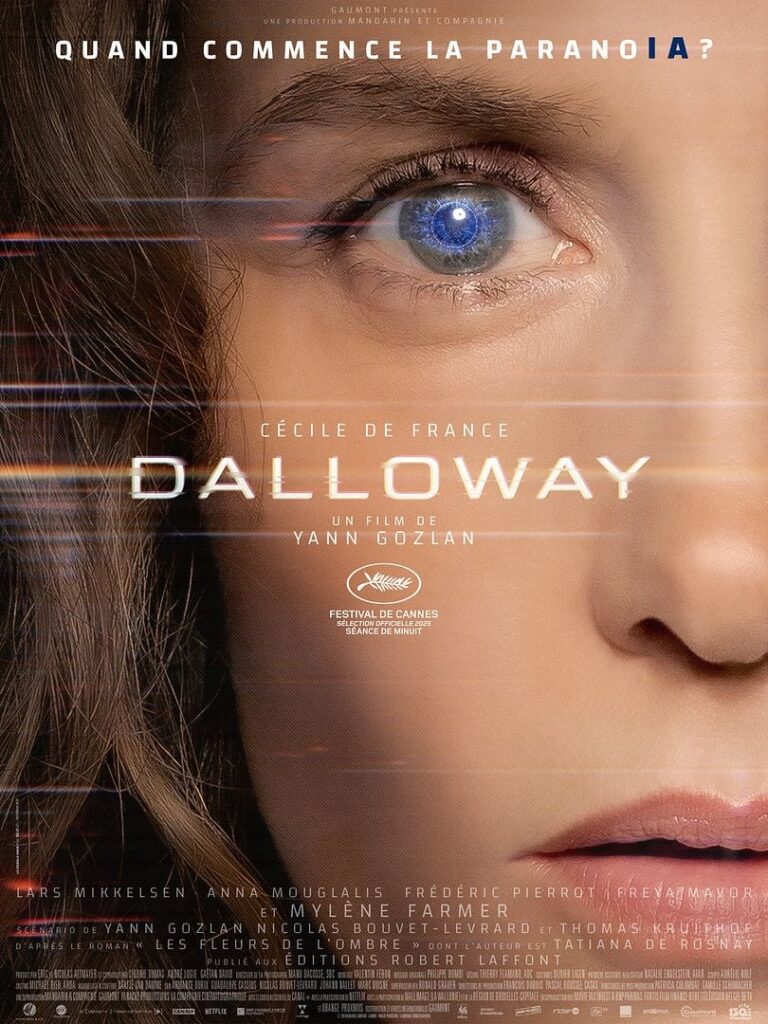Brésil, 1977 : Marcelo (Wagner Moura), un homme d’une quarantaine d’années au passé obscur, arrive à Recife alors que la ville est en plein carnaval. Il s’y rend pour retrouver son jeune fils et tenter de reconstruire sa vie. Cependant, son projet est compromis lorsque les échos de son ancienne existence refont surface…
La vie de cinéphage peut parfois se confondre avec celle d’un aventurier. Entendons-nous bien : pas question d’aller se risquer en zone concrètement dangereuse, mais il faut bien l’avouer : aller voir des films peut parfois s’avérer être une vraie aventure, pour le pire ou pour le meilleur.
Ainsi, à la sortie d’une salle de cinéma pas plus tard qu’hier, où je venais d’assister à une énième variation de problèmes existentiels de bobos parigots sur grand écran (le concept de « bourgeois gaze » me fais hurler de dire, mais faut avouer qu’il y aurait quand même de quoi débattre cinq minutes sur le sujet) devant un film passant totalement à côté de son/ses sujet/s, deux options s’offraient à moi : m’inscrire au prochain week-end de survie d’une influenceuse locale – qui me promet d’arriver, à son terme, à savoir faire la différence entre l’eau froide et l’eau chaude – ou tenter conjurer le sort en enquillant un deuxième long métrage dans la foulée.

Le titre est bateau, l’affiche internationale ne vend pas du rêve, la bande-annonce est aussi limpide qu’un message codé transmis par la BBC au début des années 1940 et la durée du film (160 minutes tout de même !) semblent m’indiquer que je ferais mieux de rentrer chez moi et de me poser devant la rediffusion d’un bon vieux Faites entrer l’accusé.
Bon j’avoue : je suis vraiment le spectateur le moins informé du monde. En gros, quand je vais voir un film, je n’en sais absolument rien. Même pas, par exemple, que le réalisateur du métrage que je m’apprête à tenter est le même qui avait réalisé voilà dix ans Aquarius, dont je me souviens surtout pour la prestation magistrale de Sonia Braga. Et puis bon : une salle de cinéma, ce n’est pas une prison. Donc…
Instantanément, c’est une révélation. Dès la longue scène d’ouverture, dont on saisit instantanément qu’elle n’aura pas d’autre lien avec le film que de présenter son personnage principal (non, ce n’est pas Pedro Pascal), je sais que je suis devant un vrai film. A savoir quelque chose ayant été initié par un vrai amoureux du Septième Art. Donc une personne ayant pour principale mission de vouloir partager des émotions avec autrui, le tout avec grand talent et surtout sans prétention ni la moindre arrogance intellectuelle (définitivement le pire fléau de la civilisation occidentale).

Aucun doute possible donc : Kleber Mendonça Filho, réalisateur de L’agent secret, est un vrai dingue de cinéma. Pas juste un gougnafier tout juste sorti d’une prestigieuse école de cinéma (qui généralement apprend en premier lieu à ses élèves à savoir tenir une posture arrogante, plutôt à savoir transmettre quelque chose), mais bel et bien quelqu’un ayant passé de nombreuses années à partager sa passion justement – entre autres, via son activité de programmateur dans une salle de cinéma de sa ville natale – avant de passer derrière la caméra.
Impossible à ranger dans une case, L’agent secret est donc une œuvre qui respire l’amour du grand écran dans chacun de ses plans. A la fois drame intense, thriller politique et chronique sociale du Brésil alors sous dictature militaire, le long métrage suit une trajectoire narrative basée sur le principe hautement casse-gueule des flashbacks imbriqués.

Se permettant même des incartades à la limite du fantastique (sans que l’ensemble n’en devienne grotesque), ponctuant l’ensemble de références (qui n’en deviennent pas un gimmick constant comme chez Tarantino), Kleber Mendonça Fihlo livre ici un grand film, à la limite de l’Epic, dont le ton général – empreint d’une lenteur à l’intensité intacte mais jamais poussive – fait penser, la violence graphique en moins, au cinéma de Craig Zahler (Bone Tomahawk, Section 99, Traîné sur le bitume), dont on attend avec grande impatience le prochain métrage.
Parfois, la prise de risque cinéphilique peut s’avérer payante. C’est à l’évidence le cas de cet Agent secret qui, bien que risquant de rater une partie de son public (faute à une promo bien mal ciblée), restera à coup sûr comme l’une des meilleures choses à voir cette année au cinéma. Il ne serait d’ailleurs guère étonnant de voir O Secreto Agento repartir avec les statuettes du meilleur film étranger, que ce soit à Hollywood où aux César…

L’agent secret (O Secreto Agento) de Kleber Mendonça Filho, avec Wagner Moura, Carlos Francisco, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido, Robério Diogenes, Udo Kier, Brésil/France/Allemagne/Pays-Bas, 2h41.