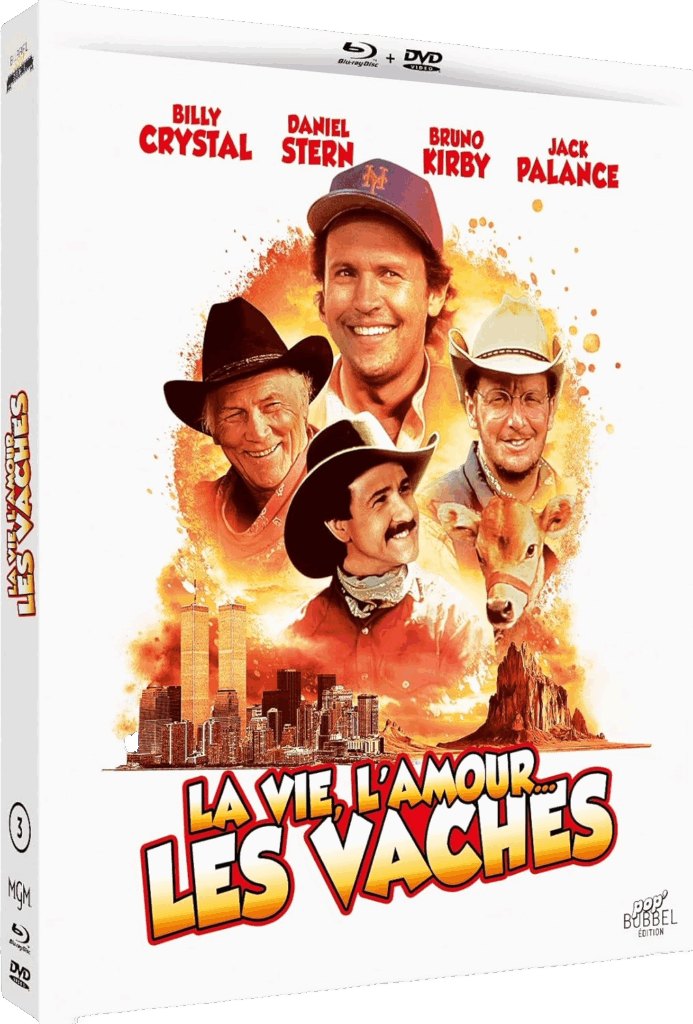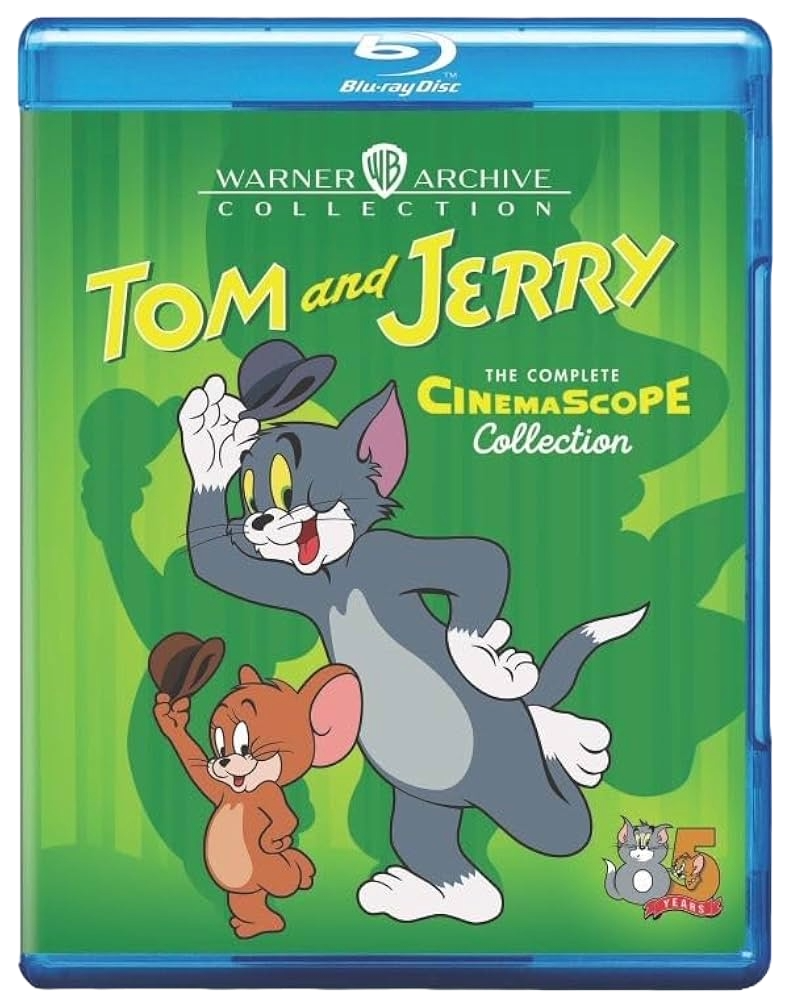Pour Drew Baylor (Orlando Bloom), il existe une réelle différente entre l’échec et le fiasco. Concepteur d’une paire de baskets qui s’annonce comme la catastrophe de l’année avant même d’avoir été mise sur le marché, ce jeune adulte, devenu spécialiste de ce qu’il appelle « le dernier regard » depuis son licenciement, est bien décidé à mettre fin à ses jours.
C’est au moment même où il est sur le point de réaliser son triste projet que Drew reçoit un appel de sa sœur pour lui annoncer le décès de son père Mitch. Bien obligé de différer son suicide, Baylor est chargé en tant qu’aîné de la famille de se rendre à Elizabethtown, ville natale de son paternel, afin de régler les détails de ses funérailles. Dans l’avion qui le conduit à cette petite bourgade perdue du Kentucky, Baylor sympathise avec Claire Colburn (Kirsten Dunst), une hôtesse de l’air espiègle et farfelue…

Cinquième film du cinéaste Cameron Crowe, Rencontres à Elizabethtown est, après Singles et Presque Célèbre, à nouveau une œuvre en grande partie autobiographique. Se basant sur le souvenir des impressions ressenties lors du brusque décès de son propre père, le cinéaste signe une œuvre en demi-teinte magnifique, profondément mélancolique mais jamais triste. Baylor, le héros du film, n’hésite d’ailleurs pas à différencier les deux états, considérant la tristesse comme l’abdication, ce qui ne sera au final pas le cas du personnage central d’Elizabethtown.
Produit par Tom Cruise, avec qui le réalisateur a déjà travaillé par deux fois (Jerry Maguire et Vanilla Sky), Rencontres à Elizabethtown risque malgré tout de rebuter les spectateurs qui n’auraient jamais palpé toutes les nuances délicates et au final bénéfiques pour l’existence d’un état mélancolique.

Les autres, pour qui ce passage serait bien connu, sont invités à se rentre rapidement en salle car il y a fort à parier pour que ce magnifique film ne fasse qu’un passage éclair au cinéma, comme ce fut déjà malheureusement le cas de Presque Célèbre, le précédent long métrage du réalisateur. Dommage, car les œuvres de Cameron Crowe, à y regarder de plus près, sont assurément ce qu’il restera de meilleur du cinéma de notre époque.
Comme à son habitude, Cameron Crowe, ancien journaliste au sein du mythique magazine Rolling Stone, a fait de la bande originale de Rencontres à Elizabethtown une magnifique collection de chanson, passées et présentes, qui colle au film comme une deuxième peau. Maints standards folks juxtaposent donc de récents morceaux initiés par les artisans de la nouvelle scène indépendante américaine. Une somptueuse collection de balades nostalgiques à écouter sans fin
Texte originellement publié dans la presse romande en novembre 2005.

Où voir le film ?
Comme pronostiqué en novembre 2005, moment où paru originellement la présente chronique, Elizabethtown fut un flop retentissant en salles. Pas étonnant dès lors qu’actuellement, aucune édition HD ne soit disponible ailleurs qu’aux Etats-Unis sans la moindre option française. La seule possibilité actuelle pour le public non-anglophone est de se diriger vers la seconde main ou la dématérialisation. Le film est en effet disponible (location ou vente) sur Youtube :